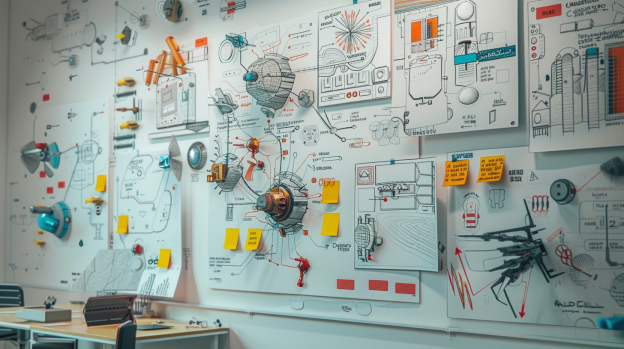Appel à ateliers
Méthodes x Futurs
Mercredi 9 octobre 2024, Université de Sherbrooke
Contexte
Dans le cycle de Dune (Herbert, 1963), l’épice apporte la prescience : elle permet aux navigateurs de traverser l’espace, aux Fremen de connaître l’avenir, et à l’Empereur d’établir sa dictature. Dans le cycle de Fondation (Asimov, 1951), l’avenir est aussi prédit par les calculs statistiques de la psychohistoire, qui s’avèrent fallacieux et manipulatoires. Hors ces fictions, la communauté scientifique ne dispose pas de tels subterfuges, mais de données et de modèles d’explication qui permettent – parfois – d’imaginer de quoi demain sera fait. Le monde de la recherche est ainsi régulièrement convoqué afin d’envisager un avenir à mesure que s’intensifie la « polycrise » (Morin et al., 1999) sanitaire, climatologique, environnementale, géopolitique, économique, technologique.
Ces dernières années ont vu apparaitre plusieurs propositions méthodologiques dans le champ des future studies, entre approches quantitatives et recours à la fiction, entre bricolages ad hoc (Nova, 2023) et protocoles standardisés (Hines & Bishop, 2013). Pour autant, à mesure que la réalité sociale se reconfigure à chaque crise, il pourrait paraitre vain de stabiliser des approches méthodologiques (Sardar & Sweeney, 2016).
La journée Méthodes x Futurs propose d’ouvrir un espace de réflexion sur ces méthodes, en interrogeant le contexte de leur convocation, leur adaptabilité aux projets pour lesquels elles sont convoquées, leur capacité à produire des leviers de mobilisation au sein des organisations et des publics, en interrogeant également leur performance ou pertinence en termes de prédiction, et enfin la portée scientifique des données qu’elles produisent.
Les avenues sont nombreuses ici, et cette journée est l’occasion de les parcourir, de les croiser, d’en ouvrir de nouvelles. Nous invitons ainsi toute personne en recherche, dans le milieu académique ou dans celui des affaires, à présenter – sous forme d’atelier réflexif – une expérimentation sur les manières d’explorer les futurs. Quelles méthodes pour quels futurs : dans quelle mesure les futurs sont-ils conditionnés par les méthodes qui les donnent à voir ?
- Inventivité : Le futur est fiction. Cela en fait-il un aiguillon pertinent pour orienter les décisions des entreprises ou des gouvernements ? Ou le terrain d’enquête doit-il coller au principe de réalité, en s’attachant aux statistiques des marchés ou en se bornant à nourrir un processus décisionnel (Williams, 2016) ? Vaut-il mieux prédire par calculs et probabilités ou par repérage des signaux faibles, et si oui lesquels ? Les imaginaires ont-ils un rôle à jouer dans cette prédiction ? En quoi leur contemplation, par exemple dans des recueils d’imaginaires (Rumpala, 2015), sert-elle le travail de prospective ? Si la fabulation spéculative de Donna Haraway est souvent brandie comme un sésame pour désinvestir des modèles de pensée dominants, comment s’y prendre : faut-il créer des mondes entiers pour sauver le nôtre (Haraway & Neyrat, 2016) ? Au-delà, quelles méthodes ouvrent une porte sur l’agentivité des imaginaires (Stépanoff, 2022) ?
- Matérialité : Le futur est tangible. Souvent, ce travail sur les imaginaires prend la forme de récits, dans la foulée du scenario-based design ; une autre tendance pousse à produire les objets du futur, comme autant d’objets-à-réaction (Le Corbusier) ou de provotypes (Kerspern et al., 2017) : qu’apporte ces méthodes issues du design for debate ? Entre design et fiction, quelles méthodes sont à privilégier ? Quels attributs des objets intermédiaires nous permettent de mieux voyager dans le futur ? Les approches artistiques (plastiques, littéraires, chorégraphiques) se distinguent-elles dans leur regard sur le futur ? Mais quelle est la factitivité de ces méthodes (Beyaert-Geslin, 2021), que permettent-elles de faire faire aux participants, de faire savoir aux organisations, de faire croire aux publics?
- Collectivité : Le futur est multiple, et il faut être plusieurs pour explorer les possibles. Qu’il s’agisse de produire des artefacts ou des récits, les méthodes contemporaines tendent à privilégier le co-design (Grosjean et al., 2019), dans la foulée des méthodes créatives de résolution de problème. Après tout, le futur émerge entre design thinking et wicked problems (Buchanan, 1992). Combien faut-il être alors pour imaginer le futur ? Quels talents, quelles compétences sont nécessaires ? Quelle intersectionnalité est requise dans ce travail ?
- Temporalité : Le futur est flou. Dans quelle mesure l’avenir doit-il paraitre familier pour être crédible ? Quel horizon est le plus pertinent, entre les Trois Lendemains (Sardar & Sweeney, 2016; Serra del Pino, 2021) ou au sein du Cône des futurs (Voros, 2017)? Un futur peut-il se définir dans le temps court des ateliers: combien faut-il de ces séances pour discerner l’avenir? Comment, dans ces temporalités, suspendre la crédulité des participants et des décideurs?
- Finalité: Le futur est vertigineux (Grimaud & Wacquez, 2023). Dans cette hypothèse quelle méthode permet de ne pas chuter, ou d’accompagner la chute si c’est la seule issue ? Comment les résultats d’une telle enquête peuvent-ils éviter de coloniser le futur (-h-, 2023) ? Dans le champ d’études des futurs, l’utopie inatteignable et la dystopie anémiante résultent-elles de biais méthodologiques, et dès lors comment les éviter ? Saisir les possibles parvient-il à produire des connaissances que la science pourrait employer ? Que valent les données fabriquées par ces méthodes ? Quelle scientificité dans ces démarches ? Ou à l’inverse, si le futur est indiscipliné dans ses méthodes, peut-il servir à redéfinir ce que serait la science à l’avenir ?
Modalités de participation
Cette journée s’insère dans un événement organisé par l’université de Sherbrooke autour des « Disruptions numériques » (du lundi 7 au mercredi 9 octobre 2024). À cette occasion sont interrogées les transformations sociales et professionnelles induites par les technologies numériques émergentes (IA, quantique, etc.). L’appel à ateliers poursuit ce fil rouge : quelles méthodes pour envisager ces disruptions? Si l’attention reste portée sur le numérique, ce dernier n’est qu’un prétexte pour expérimenter des méthodes au cours de la journée d’étude. Se déroulant au sein du Studio de Création de l’Université de Sherbrooke, les ateliers pourront durer 3h ou 6h : un pitch de lancement permettant aux personnes inscrites de choisir l’atelier auxquelles elles participeront. À l’issue de cette journée sera organisée une exposition collective, la déambulation dans le studio devenant l’espace de discussion pour mettre en contraste les futurs produits au cours des ateliers.
Les propositions doivent contenir un titre et un résumé présentant la démarche de recherche et son ancrage scientifique, la méthode employée et l’intention de production (500 mots). Ces éléments seront diffusés avec le programme. À des fins d’organisation, il est également attendu une description de la méthode (1000 mots), précisant les modalités pratiques (déroulé de l’atelier, nombre de participants, type d’espace souhaité pour l’atelier, matériel requis, durée prévue, conditions d’exposition).
Ces éléments doivent être envoyés aux organisateurs par courriel (julien.pierre@usherbrooke.ca et guillaume.madore2@usherbrooke.ca) avant le 15 juin. Les évaluations du comité scientifique seront retournées avant le 15 juillet.
Comité d’organisation
- Pr Julien Pierre, Département de communication, Université de Sherbrooke
- Félix Baril, Université de Sherbrooke
- Guillaume Madore, Université de Sherbrooke
Comité scientifique
- Pr Julien Pierre, Département de communication, Université de Sherbrooke
- Pr Dany Baillargeon, Département de communication, Université de Sherbrooke
- Guillaume Madore Université de Sherbrooke;
- Marie-Julie Catoir-Brisson, Audencia Business School
Bibliographie
Beyaert-Geslin, A. (2021). Factitivité et manipulation douce : Quelques leçons tirées de l’exposition d’objets de design. Actes sémiotiques, 124. https://doi.org/10.25965/as.6737
Buchanan, R. (1992). Wicked problems in design thinking. Design issues, 8(2), 5‑21. https://doi.org/10/fw9rj5
Grimaud, E., & Wacquez, J. (2023). Le vertige futurologique. Terrain. Anthropologie & sciences humaines, 79, Article 79. https://doi.org/10.4000/terrain.25613
Grosjean, S., Bonneville, L., & Marrast, P. (2019). Innovation en santé conduite par les médecins et infirmières : L’approche du design participatif à l’hôpital. Innovations, 60(3), 69‑92. https://doi.org/10.3917/inno.pr2.0066
-h-. (2023). Extase fiction. Terrain. Anthropologie & sciences humaines, 79, Article 79. https://doi.org/10.4000/terrain.26109
Haraway, D., & Neyrat, F. (2016). Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene. Multitudes, 4, 75‑81. https://doi.org/10.3917/mult.065.0075
Hines, A., & Bishop, P. C. (2013). Framework foresight : Exploring futures the Houston way. Futures, 51, 31‑49. https://doi.org/10.1016/j.futures.2013.05.002
Kerspern, B., Lippera, L., & Hary, E. (2017). ProtoPolicy, le Design Fiction comme modalité de négociation des transformations sociopolitiques. Sciences du Design, 1, 103‑113. https://doi.org/10.3917/sdd.005.0103
Nova, N. (2023). Futurs alpins. Terrain. Anthropologie & sciences humaines, 79, Article 79. https://doi.org/10.4000/terrain.25943
Rumpala, Y. (2015). Littérature à potentiel heuristique pour temps incertains. Methodos. Savoirs et textes, 15, Article 15. https://doi.org/10.4000/methodos.4178
Sardar, Z., & Sweeney, J. A. (2016). The Three Tomorrows of Postnormal Times. Futures, 75, 1‑13. https://doi.org/10.1016/j.futures.2015.10.004
Serra del Pino, J. (2021). Building Scenarios With the Three Tomorrows. World Futures Review, 13(2), 101‑114. https://doi.org/10.1177/19467567211025562
Stépanoff, C. (2022). Voyager dans l’invisible : Techniques chamaniques de l’imagination. la Découverte.
Voros, J. (2017). Big History and Anticipation. Dans R. Poli (Éd.), Handbook of Anticipation : Theoretical and Applied Aspects of the Use of Future in Decision Making (p. 1‑40). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31737-3_95-1
Williams, R. J. (2016). World Futures. Critical Inquiry, 42(3), 473‑546. https://doi.org/10.1086/685603